Par Sébastien Carassou (@FlashCordon sur Twitter et Mastodon)
Le 20 Octobre dernier, un intriguant séminaire s’est tenu dans les locaux de l’Agence spatiale française. Organisé à l’occasion de l’Assemblée générale de la Société Française d’Exobiologie, celui-ci avait pour titre « Trop tard pour faire de l’exobio ? Exobiologie et Enjeux Climatiques« . Cette demi-journée d’échanges interdisciplinaires a donné lieu à de nombreuses discussions passionnées, et a constitué un précieux moment de réflexivité de la part de la communauté de l’exobiologie. À l’heure où la question écologique est devenue omniprésente dans le débat public, et où les appels à la transition écologique de nos sociétés se font de plus en plus pressants, il devient nécessaire pour la communauté scientifique de s’interroger sur les impacts (voire sur la légitimité) de ses pratiques. Dans ce cadre, les idées avancées au cours de cette demi-journée ont largement de quoi contribuer au débat public sur ces questions. Voici donc un petit compte-rendu (augmenté et reformulé par mes soins) de ce que j’ai personnellement retenu durant ce séminaire. Celui-ci sera forcément subjectif et non-exhaustif. C’est pourquoi j’invite les différents intervenants cités ci-dessous à me contacter si mon interprétation de leurs idées a trahi l’esprit de ce qu’ils ont voulu communiquer.
François Forget (astrophysicien au LMD) : peut-on justifier les recherches en exobiologie et planétologie face à la crise climatique ?
Dans certains cercles, l’exploration spatiale a mauvaise presse. « Pourquoi envoie t-on autant de fusées polluantes dans l’espace, et pourquoi dépense t-on autant d’argent public pour envoyer des satellites et des sondes dénicher d’hypothétiques traces de vie ailleurs, alors même que la biodiversité s’érode aujourd’hui sur Terre ? » François Forget entend apporter quelques éléments de réponse face à cette remarque récurrente dans le débat public.
Tout d’abord, les recherches en exobiologie sont porteuses de plusieurs messages forts. S’il est encore impossible de savoir à quel point la vie est un phénomène commun à l’échelle du cosmos, on peut néanmoins affirmer, à la lumière des connaissances actuelles, que la vie terrestre est unique en son genre, et par conséquent extraordinairement précieuse : quelque soit ce que l’on trouve ailleurs dans l’univers, il n’y aura pas de planète B. D’autre part, dans le cadrage-même de ses questionnements, l’exobiologie promeut une vision unifiée du vivant sur Terre, et conçoit notre planète comme un vaisseau spatial dont nous sommes tou.tes les passager.es.
Quid de la planétologie ? Selon Forget, cette discipline nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre dans son contexte cosmique. Ainsi, de la même façon que l’on étudie l’anatomie humaine en relation avec les autres animaux (via une discipline appelée anatomie comparée), on peut faire de la planétologie comparée, et généraliser ainsi de nombreux concepts de géologie et de climatologie. Grâce à la planétologie comparée, on peut aussi analyser des phénomènes qui sont très subtiles sur Terre, mais qui jouent un rôle majeur dans l’évolution d’autres planètes.
Grâce à l’étude du climat extrême de Vénus (dont l’atmosphère est composée à 96 % de CO2 et dont la température de surface dépasse les 460° C) à la fin des années 60, les scientifiques ont pu mettre en évidence le phénomène d’emballement de l’effet de serre (runaway greenhouse), que l’on peut appliquer à notre planète : si l’on rapprochait la Terre du Soleil, une plus grande fraction de l’eau des océans s’évaporerait dans l’atmosphère. Et comme l’eau est un puissant gaz à effet de serre, la surface de la Terre deviendrait de fait plus chaude, ce qui favoriserait l’évaporation d’une plus grande fraction des océans, entraînant la Terre dans une spirale mortelle (une boucle de rétroaction positive, dans le jargon). Un rapprochement de notre planète de seulement 5% suffirait ainsi à rendre la surface de la Terre inhabitable pour toujours.
Dans l’Histoire, l’étude des autres planètes a aussi permis d’identifier (directement ou indirectement) et de réduire des risques qui pourraient menacer les conditions d’habitabilité de la Terre.
Dans les années 70, on a remarqué que le niveau de CO2 dans la haute atmosphère de Vénus était beaucoup plus élevé que ce que prédisaient les modèles. On a fini par découvrir que les processus qui préservent le CO2 à cet endroit sont liés à la présence de chlore, un élément très réactif chimiquement et qui a tendance à détruire les molécules d’ozone. Or, à la même époque, on utilisait massivement des chlorofluorocarbures (CFC) sur Terre, notamment dans le fluide frigorigène des réfrigérateurs et dans les gaz propulseurs des aérosols. L’étude de la chimie du chlore dans l’atmosphère de Vénus a donc permis de révéler le rôle des CFC comme catalyseur dans la destruction de la couche d’ozone sur Terre. Cette découverte, réalisée par Franck Rowland et Mario Molina en 1974, a été récompensée par le prix Nobel de chimie en 1995.
Pendant la Guerre froide, l’étude des tempêtes globales de poussière sur Mars a fourni à certains chercheurs américains des outils qui leur ont permis de modéliser les conséquences d’une guerre nucléaire sur le climat. Ces recherches ont donné lieu au concept d’hiver nucléaire (TTAPS, 1983) : un refroidissement dramatique de la planète causé par la stagnation des aérosols des explosions dans la stratosphère. Si ce concept est un peu désuet aujourd’hui, scientifiquement parlant, les débats que l’étude TTAPS a suscité ont joué un rôle majeur dans l’effort de désarmement nucléaire des États-Unis et de l’URSS à la fin des années 80.
Enfin, la planétologie comparée et les sciences des paléoclimats permettent aux climatologues de tester leurs outils ainsi que les concepts développés pour comprendre les climats terrestres.
Ainsi, les modèles utilisés pour reproduire le fonctionnement actuel du système Terre (comme celui développé par l’IPSL par exemple) et qui sont mentionnés dans les rapports du GIEC sont testés dans les conditions vénusiennes et martiennes. Si ces modèles parviennent à reproduire les conditions exotiques observées sur d’autres mondes (ou dans le passé lointain de la Terre), ils sont d’autant plus fiables et précis. Et nous avons besoin de modèles précis pour augmenter la résilience de nos sociétés face à la menace du changement climatique.
En guise de conclusion, Forget met l’accent sur la popularité des thèmes de l’exploration spatiale et de la recherche de vie ailleurs dans les médias et le débat public. Ces thèmes fascinent les foules, ce qui les rend particulièrement utiles pour mettre les sciences en culture.
Jurgen Knödlseder (astrophysicien à l’IRAP) : L’empreinte carbone des infrastructures de recherche en astronomie
Jürgen Knödlseder est l’un des auteur.ices d’un article publié en Mars dernier dans la revue Nature Astronomy qui a récemment fait grand bruit dans la communauté astronomique. Dans cet article, ses collaborateur.ices et lui ont tenté une première estimation de l’empreinte environnementale de l’intégralité des infrastructures de recherche en astronomie (note : le terme « infrastructure » désigne ici les télescopes spatiaux et au sol, ainsi que les sondes spatiales). Une tâche particulièrement difficile à accomplir, étant donné le manque criant de données publiques de la part des organisations astronomiques sur leurs émissions de gaz à effet de serre.
Évaluer l’empreinte environnementale des observatoires consiste à recenser l’intégralité des flux de matière et d’énergie dont l’activité des astronomes travaillant dans ces observatoires dépend. En d’autres termes, il s’agit de réaliser une analyse du cycle de vie de ces infrastructures. En extrapolant les résultats de l’analyse du cycle de vie d’un échantillon de 85 infrastructures astronomiques, les auteur.ices de l’article concluent que l’ensemble des infrastructures contemporaines de recherche en astronomie émettent chaque année plus d’un million de tonnes équivalent CO2, ce qui représente une empreinte d’environ 36 tonnes équivalent CO2 par astronome par an (un nombre qui peut monter à 60 tonnes si l’on inclut les émissions associées au style de vie moyen d’un.e astronome). La conclusion est assez embarrassante : les observatoires (au sol et dans l’espace) représentent donc LA contribution majeure à l’empreinte carbone des astronomes.
Note personnelle : à titre de comparaison, selon un rapport du laboratoire des inégalités mondiales publié en 2019, les 10 % les plus riches de la planète émettent en moyenne 31 tonnes de CO2 par personne et par an, contre 1,6 tonnes pour les 50 % les plus pauvres.
Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et respecter ainsi l’objectif fixé par les États lors de l’Accord de Paris, chaque personne sur Terre ne devrait pas émettre (en moyenne) plus de 2 tonnes de CO2 par an d’ici 2030. Selon Knödlseder, la communauté astronomique a donc un devoir d’exemplarité dans la gestion de ses propres émissions de gaz à effets de serre. Elle doit reconnaître sa responsabilité et agir en conséquence, en œuvrant à la décarbonisation des infrastructures de recherche actuelles, mais aussi en réduisant la vitesse à laquelle les infrastructures à venir se développent. Dans cette quête, les bonnes volontés individuelles des astronomes ne suffiront pas : non seulement la décarbonisation doit absolument devenir une priorité de financement dans les années à venir (ce qui n’est envisagé par aucun organisme de recherche aujourd’hui), mais des plans d’actions aux objectifs chiffrés doivent être mis en place, et les résultats de ces plans doivent être rendus publiques. Pour le moment, rares sont les organismes de recherches à s’être lancés dans une telle entreprise. Une exception notable est l’ESO : depuis quelques années, l’observatoire européen austral réalise ainsi son bilan carbone annuel, et a mis en place un plan d’action pour décarboner au maximum ses activités.
Hervé Philippe (phylogénomicien à la Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale, Moulis) : la recherche peut elle sauver l’environnement ?
L’UNESCO a récemment déclaré que l’année 2022 serait « l’année de la science fondamentale pour le développement durable ». Selon l’organisation internationale, la science fondamentale serait absolument vitale pour améliorer la qualité de vie des humains à travers le globe et atteindre les objectifs de développement durable. Mais est-ce vraiment le cas ?
Hervé Philippe propose de tester ce qu’il appelle « l’hypothèse du savoir« , selon laquelle « une meilleure connaissance scientifique est la clé de la protection de l’environnement ». Pour tester cette hypothèse, il a mesuré l’évolution du nombre total d’articles scientifiques en fonction des taux d’émissions de CO2 par humain entre 1975 et 2014 (ce qui correspond à la période à partir de laquelle les enjeux écologiques commencent à être bien connus), et il a observé une forte corrélation entre ces deux variables.
S’il est bien conscient que corrélation n’implique pas forcément causalité, le phylogénomicien avance néanmoins l’idée selon laquelle une bonne partie de nos pratiques scientifiques participent, directement et indirectement, à la dégradation de l’environnement. En effet, la science fournit à la fois des outils de domination des humains (à travers la place qu’elle occupe dans le complexe militaro-industriel et l’appareil étatique) et des outils de domination de la nature (à travers le développement de technologies d’exploitation des ressources naturelles toujours plus efficaces).
Au cours des dernières décennies, l’empreinte environnementale des recherches scientifiques n’a fait que croître : les scientifiques utilisent des bases de données de plus en plus grandes, et des infrastructures de recherche de plus en plus imposantes et de plus en plus gourmandes en ressources et en énergie. Ainsi, le CERN consomme aujourd’hui près de 1,3 TWh d’électricité par an, soit autant que les 24 millions d’habitants de Madagascar. Autre exemple, la recherche en biologie est aujourd’hui responsable de près de 2% de la production de plastique à l’échelle globale.
Philippe nous met enfin en garde contre l’idéologie scientiste et techno-solutionniste, qui favorise le rejet de la démocratie en faveur de l’épistémocratie. Cette idéologie est aussi responsable d’une véritable “économie de la promesse”, qui se traduit par une foi sans faille des dirigeant.es dans l’innovation technologique (centrales à fusion nucléaire pour décarboner la production d’énergie, techniques de géo-ingénierie pour capturer le CO2 de l’air…) et par une légitimation du dogme de la croissance infinie dans un monde aux ressources pourtant finies. Le chercheur appelle donc à repenser notre rapport à la science, et à distinguer ce qu’il nomme science galiléenne, basée sur un objectif de compréhension du monde, d’une science prométhéenne, associée à des velléités de contrôle et de possession.
Patrick Hennebelle (astrophysicien au CEA de Saclay) : présentation du collectif « Labos 1.5 »
Labos 1.5 est un collectif né en mars 2019 à l’initiative de Tamara Ben-Ari, chercheuse à l’INRAE, et d’Olivier Berné, astrophysicien à l’IRAP. Il réunit des membres du monde académique, de toutes disciplines et à travers la France, dans le but de mieux comprendre et de réduire l’impact des activités de recherche scientifique sur l’environnement, en particulier sur le climat. Les activités de « Labos 1.5 » sont désormais organisées au sein d’un Groupement De Recherche soutenu par le CNRS, l’INRAE, l’ADEME et l’INRIA.
L’une des actions majeures du collectif est d’avoir mis à disposition de la communauté scientifique GES 1point5, un outil en ligne libre et gratuit permettant aux laboratoires de calculer leur empreinte carbone et de réaliser leur bilan gaz à effet de serre. Cet outil a dores et déjà permis de réaliser plus de 900 bilans GES dans plus de 500 laboratoires à travers la France. La collecte de données qui en a résulté a permis au collectif de réaliser une étude à l’échelle nationale relative à l’empreinte carbone de la recherche publique. Cette étude n’est pas encore publiée, mais les résultats préliminaires sont déjà clairs : si de grandes disparités d’émissions entre les laboratoires existent, le bilan GES global des laboratoires est aujourd’hui très largement dominé par les achats divers, mais aussi (dans une moindre mesure) par le chauffage et les déplacements en avion et en voiture. Voilà donc les leviers d’actions les plus efficaces à ce jour pour décarboner le monde de la recherche.
Le collectif entend aussi accompagner les laboratoires dans leur transition écologique, et a déjà initié une phase de test entre juin 2021 et août 2022 auprès d’une vingtaine de laboratoires pilotes. À terme, l’objectif est de produire un kit d’action qui sera diffusé dans les mois à venir afin d’initier un mouvement de laboratoires en transition.
En parallèle, une équipe de réflexion composée d’expert.es a été établie pour animer les débats de fond dans le monde de la recherche autour des enjeux techniques, politiques et sociaux de la transition écologique. Elle organise notamment des cycles saisonniers de séminaires dans le but de former les chercheur.es à ces questions et de développer une culture commune. Les rediffusions de ces séminaires sont disponibles sur la chaîne Peertube du collectif.
Dominique Bourg (philosophe à l’Université de Lausanne) : imaginer la science du futur
Pour Dominique Bourg, l’enjeu du changement climatique n’est rien de moins que l’habitabilité de la planète. En effet, si nous ne sommes pas encore entrés dans la 6e extinction de masse de l’histoire de la Terre, tout porte à croire que nous nous dirigeons tout droit vers elle. Au cours des derniers 100 000 ans, la biomasse des mammifères sauvages a été divisée par 6, et ces derniers ne représentent aujourd’hui plus que 4% de la biomasse de l’ensemble des mammifères de la planète, le reste étant constitué du bétail (60%) et des humains (36%). Selon le dernier rapport de l’IPBES, cet effondrement rapide du vivant est causé par plusieurs facteurs. Par ordre décroissant d’impact : les changements d’usage de la terre et de la mer, l’exploitation des organismes, le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes.
Un cadre pertinent pour penser l’impact global des activités humaines sur le système Terre est celui des limites planétaires, proposé en 2009 par une équipe internationale de chercheur.es dirigée par Johan Rockström et Will Steffen, et mis à jour en 2015. Ce cadre définit une collection de seuils à l’échelle mondiale que l’Humanité ne devrait pas dépasser si elle veut continuer à vivre durablement dans un écosystème sûr et relativement stable. Sur les 9 seuils identifiés, 6 ont déjà été dépassés : le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, la modification de l’occupation des sols, la pollution chimique et l’utilisation d’eau douce.
Selon Dominique Bourg, ces dérèglements s’expliquent en partie par le rapport que nous entretenons avec nos connaissances. En effet, une caractéristique des connaissances de nos sociétés modernes occidentales est qu’elles sont nécessairement partielles, incomplètes. Pourtant, cette incomplétude n’empêche pas d’alimenter notre arrogance. Le philosophe donne l’exemple des CFC, que l’on savait inertes chimiquement parlant, mais dont l’utilisation en masse dans les réfrigérateurs et les aérosols en spray a finalement mené à l’érosion de la couche d’ozone au cours des années 70.
Pourtant, notre rapport aux connaissances n’est pas le seul possible. Ainsi, chez les Yanomami, un peuple de chasseurs-cueilleurs situés entre le Sud du Venezuela et le Nord du Brésil, l’intégralité des connaissances sont prescriptives et servent à la protection de leur milieu. Il n’y a donc pas de séparation entre la connaissance et la sagesse. Par exemple, l’idée que certains arbres avaient un rôle majeur à jouer dans l’avènement des pluies est un savoir traditionnel transmis au travers de la cosmogonie yanomami sous la forme de Maa hi, le grand arbre de la pluie. La découverte des propriétés de ces arbres par les colons européens n’a été que bien plus tardive (de nos jours, on sait que ces arbres jouent un rôle dans l’humidité d’un territoire en émettant des aérosols via le phénomène d’évapotranspiration).
Bourg appelle les scientifiques à remplacer leur arrogance habituelle par la prudence, et à repenser leurs relations au vivant et à la connaissance en y incluant une dimension morale. Il invite donc à privilégier les sciences du diagnostic, forcément interdisciplinaires (dont la pratique est incarnée par des organismes comme le GIEC ou l’IPBES) aux sciences dites “agissantes” (ou “prométhéennes”, pour reprendre la terminologie d’Hervé Philippe). Une initiative allant dans ce sens est « la Fabrique des questions simples« , un incubateur pour une recherche impliquée lancé en 2021 par le physicien Pablo Jensen.

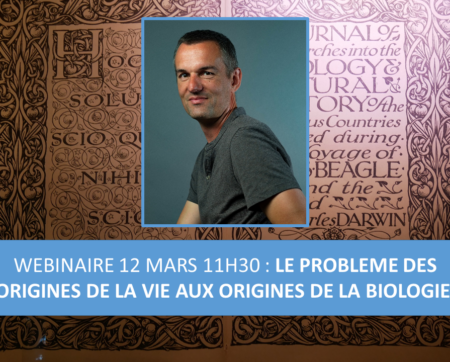
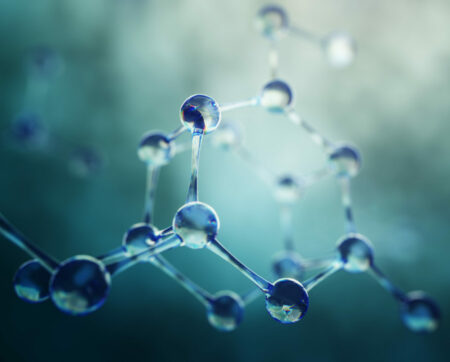
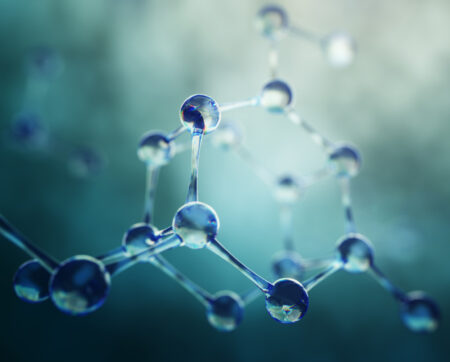

Aucun commentaire sur l'article Compte-rendu de la matinée « Exobiologie et enjeux climatiques »